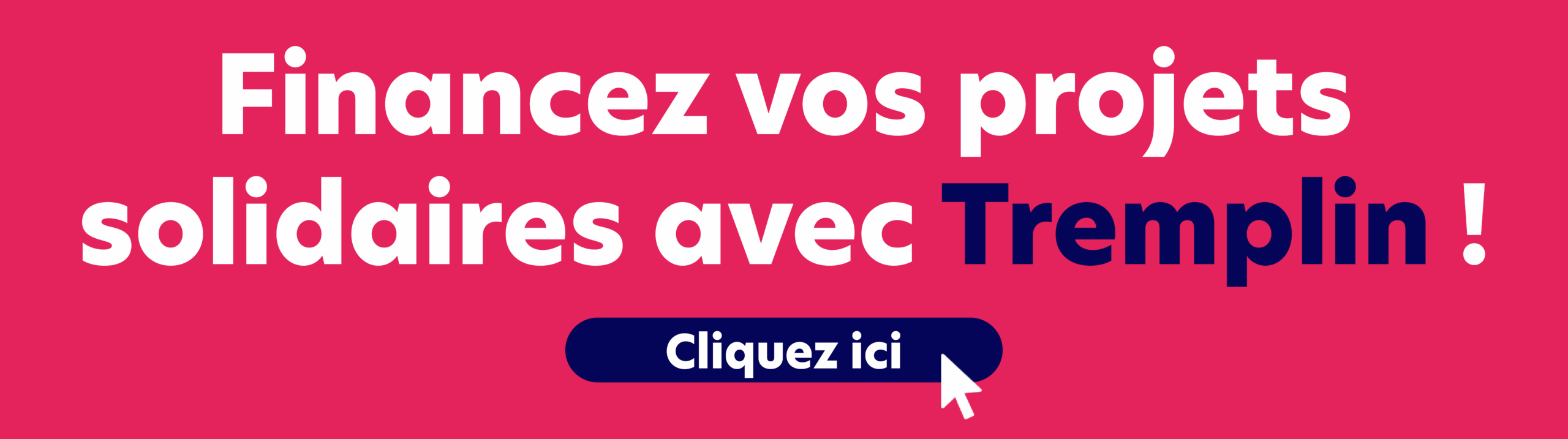15 janvier 2026
25 novembre 2025
Elimination de la violences à l’égard des femmes – L’interview de l’ADSF
En cette journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) a choisi de mettre en lumière les enjeux relatifs à la santé mentale des femmes en situation de grande précarité, et les liens que cette question entretient avec celle des violences sexistes et sexuelles.
L’entretien qui suit a été réalisé auprès de l’association l’ADSF – Agir pour la santé des femmes – qui vise à améliorer la prise en charge et l’état de santé globale des femmes en situation de grande exclusion en organisant des actions favorisant leur accès à des soins adaptés à leur genre et à leur parcours de vie, à travers des maraudes et au sein de ses accueils de jour parisien et lillois. Dahlia Stern, psychologue à l’ADSF, a répondu à nos questions.
Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) : Dans le cadre de votre travail, avez-vous développé des pratiques spécifiques pour accompagner au mieux les femmes en situation de grande précarité ?
Dahlia Stern (psychologue à l’ADSF) : Nous sommes deux psychologues à temps partiel à l’association. Avec ma collègue, nous avons beaucoup réfléchi à la nécessité d’ouvrir certains « dossiers » que les femmes ne vont pas avoir les moyens de traiter, parce que justement elles sont en situation de précarité, en se demandant si c’était la priorité de « déballer les traumas ». Le trauma réactive en permanence le système d’alarme du cerveau, générant une angoisse constante. Le fait d’être à la rue, d’être exposée à de potentielles nouvelles violences, renforce ce sentiment de vulnérabilité intense. Pour se protéger, il va s’opérer une dissociation entre les événements traumatiques et la situation actuelle. Lorsque nous les accompagnons, nous essayons d’être vigilantes à ne pas réactiver des émotions ou des événements, si nous n’avons pas un minimum confiance dans le fait qu’elles auront la capacité d’y faire face.
À l’ADSF, j’ai développé des pratiques adaptées à un public de femmes en situation de grande précarité, très souvent victimes de violences. On a donc des récits qui sont émaillés de petits et grands traumas, avec une symptomatologie qui est réactionnelle. J’ai donc eu recours aux techniques de stabilisation, qui permettent aux personnes de se reconnecter à elles-mêmes, d’être dans le présent et éventuellement de sortir un peu de la sidération ou de moments d’émotions trop fortes.
Formée à enseigner le yoga, j’utilise également des techniques de respiration et de visualisation que je me suis autorisée à utiliser pour favoriser la régulation émotionnelle. J’ai l’impression que ces outils sont bien accueillis parce qu’il y a quelque chose d’assez concret : travailler sur la respiration, faire des petits exercices qui amènent aussi des moments où on peut rire, qui dédramatisent un peu le moment. Parfois, plusieurs mois après, des dames ont pu me dire « oui je fais ce que vous m’avez dit et ça fait du bien quand je le fais ».
D’ailleurs, dans le champ du psycho-trauma, on entend aussi que la parole n’est pas forcément la meilleure thérapie, a fortiori chez des femmes présentant des psycho-trauma complexes, des parcours de migration au cours desquels la violence est omniprésente. La parole même si elle peut constituer un moment important, parce que parfois, lorsqu’on les rencontre, elles n’ont jamais raconté ce qui leur était arrivé, ce n’est pas la thérapie qui est toujours la plus recommandée. Nous avons donc appris à remettre en question nos pratiques pour pouvoir les accompagner là où elles sont.
On oriente beaucoup vers nos autres activités thérapeutiques comme l’art thérapie, la sophrologie, la danse libre, avec des intervenantes extérieures qui ont une approche de prendre soin et offrent ainsi des espaces de respiration où les femmes peuvent se ressourcer.
Enfin, à l’ADSF, il y a aussi des femmes « Repaires », qui ont connu des situations similaires à celles de nos bénéficiaires. Elles sont présentes au quotidien à l’accueil de jour et en maraude, selon le modèle triptyque « une salariée, une femme-repaire, une bénévole » que l’on a développé. Il est arrivé qu’en maraude, une collègue femme-repaire, dise, « moi j’ai été là où tu as été et regarde, tu vois, je sais qu’on peut s’en sortir, il faut s’accrocher ». Ce sont des choses que je ne peux pas dire parce que je ne les ai pas vécues. Et donc, la pair-aidance c’est une ressource, elles ont une expertise et un regard qui nous enrichit beaucoup.
FAS : Quels sont, selon vous, les plus grands défis auxquels vous êtes confrontée dans votre quotidien de psychologue à l’ADSF ?
Dahlia Stern : Le défi c’est la précarité. Il peut se passer quelque chose en une fois, mais l’idéal serait que l’on puisse les revoir mais leur situation fait que c’est très difficile de les accrocher sur du soin. D’ailleurs, je ne sais pas toujours si je peux parler de thérapie car ça implique de la régularité, un cadre stable, qui ne peut pas vraiment leur être proposé au vu de leur situation. On aussi a beaucoup de femmes qui oublient leur rendez-vous du fait de la dissociation, des troubles de l’attention, de la mémoire… Elles sont éparpillées. La précarité fait qu’on doit traverser la ville dans tous les sens pour le matin aller chercher à manger et puis après aller récupérer le courrier à la domiciliation… Donc nous, à l’association, nous les appelons la veille et nous leur rappelons leur rendez-vous.
L’autre défi lié à la précarité, c’est la question du prendre soin en sachant que les besoins fondamentaux ne sont pas sécurisés. Qu’est-ce que ça veut dire de prendre soin d’une personne qui ne mange pas à sa faim, qui ne dort pas dans des conditions dignes, qui ne peut pas se laver tous les jours ? Il y a une dimension systémique qui nous dépasse largement, parce que leur santé mentale est profondément impactée au-delà de la question du psycho-trauma. Quand on les rencontre, c’est aussi la situation de précarité qui les affecte profondément, qui fait qu’elles sont fatiguées, qu’elles n’ont pas le moral, qu’il y a un sentiment pour certaines d’horizon bouché. Comment peuvent-elles nous croire quand on leur dit que ce n’est pas normal qu’elles se sentent comme ça et qu’elles ont le droit d’avoir des soins, de l’aide, de se sentir mieux psychologiquement, alors qu’elles n’ont pas les conditions minimums qui permettent normalement à une personne de pouvoir prendre soin de soi ?
FAS : Comment envisagez-vous la complémentarité de votre travail avec vos autres collègues ?
Dahlia Stern : Depuis le début de ma carrière, je travaille en équipe et je m’inscris vraiment dans une intention pluridisciplinaire. J’aime bien l’idée que l’on arrive à produire un regard commun prenant en compte toutes les facettes d’une personne. On travaille avec les médiatrices en santé, et une travailleuse sociale vient d’arriver dans l’équipe. Je pense qu’une personne qui commence à raconter ses problèmes de santé ou ses problèmes administratifs ne peut pas complètement se couper de ce que ça lui fait vivre au niveau émotionnel. La question des violences arrive souvent dans les consultations avec nos collègues sage-femmes et gynécologues. C’est pourquoi nous avons décidé de faire des consultations d’évaluation qu’on appelle « médico-psychologiques » durant lesquelles nous voyons ensemble les femmes, afin de pouvoir évaluer les besoins, orienter et prendre en charge ce qui peut être fait sur place. Nous avons vite compris l’importance d’intervenir en complémentarité. D’ailleurs, dans la grande majorité des cas, elles ne font pas de demande spontanée de voir une psychologue, donc parfois cela amène à des moments que je qualifie « de psychoéducation » où l’on explique que les troubles du sommeil, les troubles de la mémoire, les flash-backs, l’état d’hypervigilance (etc), sont des manifestations du traumatisme. Ce que j’aime bien dire parfois, c’est « vous avez une réaction normale à quelque chose qui n’est pas normal ».
FAS : Réorientez-vous toujours les femmes que vous rencontrez à l’ADSF vers des structures de soins psy ? Est-il difficile de trouver des relais ?
Dahlia Stern : Il s’agit d’évaluer les critères de risque, gravité, mais c’est très compliqué parce qu’elles méritent toutes des soins. Donc nous, on va orienter la patiente vers le secteur psy quand on a le sentiment qu’elle n’a pas forcément les ressources internes ni externes pour se maintenir, et qu’elle aurait besoin d’une aide médicalisée ». On les oriente alors vers le CPOA mais aussi vers le CAPSYS, qui est un centre médico-psychologique (CMP) non sectorisé, ou encore le centre Minkowska et l’association Femmes, entraide, autonomie, qui organise des groupes de parole. Mais nous sommes inquiètes. La situation est déjà difficile, alors si en plus des structures commencent à devoir réduire leur activité, c’est très inquiétant. Il y a de nouvelles personnes tout le temps et le système tourne en rond.
Pour en savoir plus sur l’ADSF : ADSF – Agir Pour La Santé Des Femmes